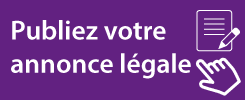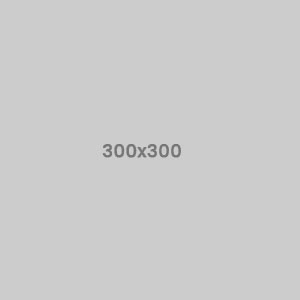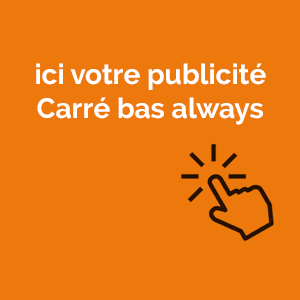La Bourgogne Franche-Comté face au défi du réchauffement climatique : le Morvan est déjà déficitaire en eau…
 « Le chercheur bourguignon Thierry CASTEL a tenu des propos inquiétants lors de son intervention aux « Récid’Eau Auxerrois » 2025 : la Bourgogne Franche-Comté est une région de l’Hexagone qui se réchauffe plus vite que la moyenne nationale. Son « château d’eau » naturel, le Morvan est déjà menacé par un déficit aquatique très préoccupant… ».
Crédit Photos : Dominique BERNERD.
« Le chercheur bourguignon Thierry CASTEL a tenu des propos inquiétants lors de son intervention aux « Récid’Eau Auxerrois » 2025 : la Bourgogne Franche-Comté est une région de l’Hexagone qui se réchauffe plus vite que la moyenne nationale. Son « château d’eau » naturel, le Morvan est déjà menacé par un déficit aquatique très préoccupant… ».
Crédit Photos : Dominique BERNERD.
Invité de la première édition auxerroise de « Récid’Eau », Thierry CASTEL, maître de conférences à AGROSUP Dijon et chercheur au Centre de Recherches de Climatologie (CRC) de l’Université de Bourgogne, a dressé un constat préoccupant : la région Bourgogne Franche-Comté se réchauffe plus vite que la moyenne nationale. Un basculement thermique qui modifie déjà le cycle de l’eau et fragilise une ressource précieuse pour l’agriculture, la biodiversité et la vie quotidienne de chacun.
AUXERRE : « L’eau et le climat sont deux objets qui dialoguent entre eux en permanence… ». Des propos introductifs qui plantent le décor et résument bien l’approche systémique que défend le climatologue dijonnais dans ses travaux. Car comprendre les mécanismes du climat régional revient à scruter les interactions permanentes entre l’hydrosphère, l’atmosphère et les surfaces continentales. Et dans ce jeu d’équilibres, la Bourgogne Franche-Comté est un territoire en pleine mutation, observé à la loupe par les chercheurs.
Depuis plus de soixante ans, les données des stations météo régionales le confirment : les températures maximales moyennes augmentent. Deux scénarios de lecture coexistent. Le premier, linéaire, évoque une hausse progressive de l’ordre de + 0,3 °C par décennie. Le second, non linéaire, met en évidence des ruptures soudaines. Selon Thierry CASTEL, deux bascules majeures ont été identifiées : l’une en 1987, l’autre en 2014. À chaque fois, le climat régional a franchi un nouveau palier thermique. Résultat : + 1,3 °C de hausse des températures entre 1988 et 2014, suivie d’une moyenne qui passe à + 2,1 °C sur la décennie suivante. Plus frappant encore : cette hausse n’est pas uniforme. Les reliefs, comme le Morvan ou le Haut-Jura, accusent une augmentation encore plus marquée. Le climatologue évoquant un « déséquilibre thermique » qui reconfigure déjà les équilibres hydriques de la région : « dans le Morvan, les anciens vous le diront : depuis une vingtaine d’années, il n’y a quasiment plus de neige… ».
Des implications majeures pour les territoires
« Le climat ne réagit pas comme un simple thermostat, mais comme un système complexe avec des boucles de rétroaction », insiste Thierry CASTEL. Ce que l’on observe aujourd’hui avec la fonte accélérée du Groenland, préfigure à une autre échelle, ce qui se produit déjà en Bourgogne Franche-Comté : « ce qu’il faut bien avoir en tête, c’est que les surfaces continentales vont se réchauffer plus fortement que les océans, c’est-à-dire que plus vous allez vers le Nord, plus l’amplitude du réchauffement est importante, à l’image du Groenland, qui a « gagné », si j’ose dire, + 6°C… ».
Dans notre région, le réchauffement s’accompagne d’une amplification des extrêmes et d’une désynchronisation des cycles hydriques. À terme, c’est la gestion même de la ressource qui devra être repensée. Ce bouleversement du régime thermique a des répercussions directes sur le cycle de l’eau : «avec la hausse des températures, on observe une évaporation accrue qui affecte tous les compartiments de la ressource…».
Moins de neige, des précipitations parfois plus intenses mais moins bien réparties, et une évapotranspiration végétale plus forte, font que les bilans hydriques s’en trouvent fragilisés. Si la ressource en eau dépend de trois mécanismes : le ruissellement de surface, les écoulements de subsurface et la vidange des nappes, ces deux dernières composantes, dites « lentes », sont particulièrement vulnérables à la hausse des températures. Leur réactivité moindre au climat laisse planer une incertitude supplémentaire et l’inertie des nappes phréatiques pourrait masquer aujourd’hui les effets de demain.

Morvan, château d’eau menacé : les nouvelles lois du cycle de l’eau
Il pleut… Il pleut même parfois beaucoup et pourtant, les sols s’assèchent. En région BFC, les données climatiques compilées depuis les années 1960 dressent un tableau contrasté du cycle de l’eau. Si les précipitations totales demeurent relativement stables, leur variabilité interannuelle est forte, et leur répartition dans l’année tend à se modifier. En parallèle, l’évapotranspiration, cette vapeur d’eau rendue à l’atmosphère par le sol et les plantes, connaît une hausse continue. En découle un déséquilibre hydrique préoccupant. Longtemps perçu comme un réservoir naturel, le Morvan subit de plein fouet les effets du changement climatique, menaçant son rôle historique de « château d’eau » de la Bourgogne. Les chiffres sont sans appel : entre 1959 et 1987, le territoire enregistrait un excédent hydrique de 296 mm, un bilan qui, sur la période 2015-2024, chute à 88 mm. Une baisse de près de 70 %, symptomatique d’un territoire qui perd sa capacité de stockage en eau. Avec pour conséquence une végétation entrant en stress plutôt, des sols qui se vidangent plus vite et des rivières asséchées en été.
À l’échelle de la région, les modélisations du bilan hydrique annuel sur plusieurs décennies montrent une dégradation constante : - 3 % d’eau dans les sols entre 1988 et 2014, puis - 7 % entre 2015 et 2024. Le Morvan, du fait de son socle granitique et de l’absence de nappes profondes, est particulièrement vulnérable souligne le chercheur dijonnais : « on n’y trouve pas de ressources profondes, ni de remontées de nappes, c’est un territoire où l’eau vient essentiellement de la pluie et la moindre altération du cycle s’y fait sentir avec d’autant plus d’intensité… ».
Le rythme saisonnier des pluies, autrefois assez régulier dans la région, évolue lui aussi. Les modèles climatiques anticipent moins de pluies au printemps et en été, et davantage en automne et hiver. Un déplacement du calendrier hydrologique qui ne coïncide plus avec les besoins de la végétation. Résultat : une montée en puissance des sécheresses estivales, de plus en plus précoces et plus longues, avec sur certains cours d’eau, des étiages atteignant des niveaux inédits, voire des écoulements devenus intermittents. Et attention aux « faux semblants » !
L’année 2024, bien que perçue comme « humide », illustre à quel point notre perception est biaisée par les repères du passé. Cette année-là, les précipitations furent dans la moyenne de la période 1980/2014, mais l’évaporation très faible, liée à un important déficit d’ensoleillement, a faussement redonné l’impression d’un retour à la normale. En réalité, elle s’inscrit dans un contexte de dérèglement structurel durable.
L’agriculture, la biodiversité, l’approvisionnement en eau potable, la prévention des crues, le tourisme, l’agroforesterie, sont autant d’enjeux désormais liés aux mutations climatiques en cours, mais les perspectives dressées par Thierry CASTEL dans ses propos de conclusion ne rassurent guère.
Si la trajectoire actuelle des émissions de gaz à effet de serre se poursuit, le Morvan pourrait devenir déficitaire en eau d’ici la fin du siècle : « le château d’eau de la Bourgogne est menacé et déjà fortement ébranlé… ».
Dans cette mécanique désormais bien enclenché, chaque degré compte. Chaque tonne de Co2 évitée a son importance, même si une partie du futur est déjà écrite du fait de l’inertie du climat et des erreurs commises. C’est la suite de l’histoire, celles des années après 2050 que nous pouvons encore écrire, mais il faut agir vite, très vite… Le combat est entamé et sur le front, l’eau est déjà en première ligne !
Dominique BERNERD